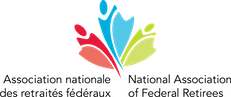Les gestionnaires de régimes de retraite canadiens investissent-ils plus au Canada? Le nationalisme économique ne cadre peut-être pas avec les obligations fiduciaires, pourtant essentielles à la sécurité du revenu de retraite.
Le mouvement « Achetons canadien », qui encourage les consommateurs à privilégier les produits nationaux, a pris de l’ampleur au cours des derniers mois. Certains y voient une occasion de relancer le débat sur la part des investissements des régimes de retraite au Canada.
En mars 2024, 92 chefs d’entreprise, dont d’anciens PDG de certaines des plus grandes sociétés canadiennes, ont signé une lettre dans laquelle ils soutiennent que les régimes de retraite canadiens délaissent les investissements nationaux et demandent aux ministres fédéral et provinciaux des Finances d’obliger les caisses de retraite canadiennes à investir dans des actions canadiennes.
Il est vrai que, avant le milieu des années 2000, les caisses de retraite investissaient proportionnellement plus au Canada, mais il est faux d’affirmer que les régimes de retraite ont réduit leurs investissements dans notre pays. Avant 1990, le Régime de pensions du Canada (RPC) et d’autres régimes canadiens étaient légalement tenus d’investir principalement dans un seul type d’actifs : les obligations canadiennes. En raison de la chute des taux d’intérêt, les caisses de retraite ont eu du mal à générer les rendements nécessaires pour respecter leurs engagements.
Les régimes de retraite ont l’obligation fiduciaire d’investir dans l’intérêt supérieur de leurs bénéficiaires. À l’évidence, un changement s’imposait.
En 2005, les restrictions sur les investissements étrangers ont été levées et les régimes de retraite ont commencé à se diversifier, afin d’assurer les meilleurs rendements possibles aux pensionnés, tout en réduisant le risque de concentration. Fini le temps de mettre tous nos œufs dans le panier des obligations.
Même si les caisses de retraite canadiennes investissent moins au Canada qu’auparavant, le montant réel en dollars a considérablement augmenté. Le Régime de retraite de la fonction publique (Investissements PSP) disposait d’environ 19 milliards $ en 2005, dont environ 70 % étaient investis au Canada (environ 13,58 milliards $). En 2025, le plan est passé à 299,7 milliards $. Même si seulement 20 % sont investis au Canada, ce montant représente tout de même 60 milliards $, soit quatre fois plus en valeur absolue.
Ce mouvement encourage aussi l’investissement dans les actions canadiennes, un marché de petite taille par rapport à l’ampleur de nos caisses de retraite. Elles représentent 3 % des actions mondiales, dont les deux tiers sont dans les secteurs de la finance et des ressources naturelles. Les possibilités de croissance et de diversification sont, tout simplement, limitées. Obliger les caisses de retraite à acheter davantage d’actions canadiennes fausserait le marché, créerait une rareté artificielle et ferait grimper les cours des actions canadiennes, ce qui profiterait uniquement aux actionnaires actuels des entreprises ciblées, et non aux Canadiens ordinaires.
Le patriotisme canadien affiché par ces PDG et gestionnaires d’investissement se fait aux dépens des retraités canadiens. Enrichir les actionnaires ne sert pas les intérêts du Canada. En revanche, garantir la sécurité financière des retraités canadiens est un enjeu d’intérêt national.
Si les gouvernements veulent qu’on investisse plus au Canada, ils ont tout intérêt à privilégier la carotte plutôt que le bâton. Les régimes de retraite souhaitent investir leurs fonds pour générer des rendements durables à long terme qui, en retour, peuvent créer des emplois stables et favoriser la croissance économique. Cela se traduit par une réglementation claire, des infrastructures adéquates et des initiatives comme les crédits d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre (dont peuvent bénéficier les sociétés de placement de fonds de retraite). Des initiatives comme celles-ci permettent aux régimes de retraite d’investir dans des entreprises et des projets d’énergie propre en conformité avec leurs engagements publics à l’égard de la durabilité.