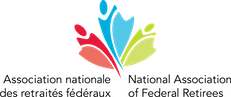En étant à l’écoute de vous-même et en rechargeant vos batteries, vous vous aidez à maintenir le contact, votre créativité et votre engagement, à long terme.
Tanya Beauchemin ne connaît que trop bien la notion de l’épuisement professionnel bénévole, à titre de cofondatrice, coordonnatrice des familles d’accueil et membre du conseil d’administration du refuge pour chiens Sit With Me.
Mme Beauchemin déclare que, pour ce qui est du sauvetage de chiens de son organisme — qui existe pour empêcher les chiens d’être euthanasiés —, « les chiens mourront » si les bénévoles ne peuvent pas assumer leurs responsabilités. C’est ce qui la motive. De même, il existe de nombreux autres postes de bénévolat à haute pression impliquant des personnes vulnérables, qui présentent les mêmes contraintes et s’accompagnent du même risque d’épuisement.
Leah Jurkovic, qui fait du bénévolat pour le refuge pour chiens Sit With Me Dog Rescue et l’organisation pour femmes Dress for Success et siège au conseil d’administration de Bénévoles Ottawa, reconnaît que le bénévolat peut être émotif épuisant.
« Il existe beaucoup d’épuisement émotionnel dans le groupe de sauvetage », dit Mme Jurkovic.
La plateforme VolunteerMatch décrit l’épuisement des bénévoles comme « un état de stress chronique qui peut mener à l’épuisement, au cynisme et au détachement ». Habituellement, cela entraîne une pénurie de bénévoles, ce qui signifie que les rares qui restent en poste doivent assumer plus de travail qu’ils ne le devraient.
La parfaite combinaison de défis
Et pourtant, les Canadien·ne·s aiment faire du bénévolat. En 2018, 24 millions de Canadien·ne·s ont consacré 2,5 millions d’heures de leur temps à améliorer la santé, le bien-être, l’éducation et la sécurité de nos collectivités, selon Statistique Canada, qui prévoit publier les chiffres de son enquête de 2023 en mai 2025.
En moyenne, les Canadien·ne·s âgés de 15 ans et plus consacraient 206 heures de leur temps en 2018, habituellement à des hôpitaux, à des organismes religieux, à des activités sportives et récréatives, ainsi qu’aux arts et à la culture. Les femmes (44 %) étaient légèrement plus susceptibles que les hommes (38 %) de faire du bénévolat, tandis que les « Z » (nés en 1996 ou plus tard) se classent au premier rang de la génération comptant le plus grand nombre de bénévoles (52 %). Cela dit, les citoyens les plus âgés du Canada (nés avant 1945) étaient moins susceptibles de faire du bénévolat, soit 32 %. Toutefois, ils donnaient en moyenne 222 heures de leur temps par an, soit près de trois fois le nombre moyen d’heures consacrées par les Z au bénévolat.
Les chiffres de 2023 feront la lumière sur ce qui s’est passé pendant la pandémie. Cependant, de façon anecdotique, Christine Trauttmansdorff, directrice générale de Bénévoles Ottawa, affirme que le nombre de bénévoles a diminué pendant la pandémie. Pendant le confinement, les programmes qui dépendaient de bénévoles ont été complètement fermés. Au fur et à mesure qu’on levait les restrictions, les bénévoles dévoués, dont beaucoup ont 60 et 70 ans, étaient un peu plus prudents par rapport à la contagion.
« Et puis il y a les données démographiques », poursuit Mme Trauttmansdorff, ajoutant que les bébé-boumeurs vieillissent et que la génération qui les suit compte beaucoup de membres. « Beaucoup de personnes qui ont pris leur retraite pendant la pandémie n’ont pas fait de bénévolat comme les gens le faisaient il y a 10 ans. »
Le confinement ne donnait pas de possibilités et bien des gens ont trouvé autre chose à faire avec leur temps. D’autres ont cessé de s’impliquer ou assument des responsabilités envers des petits-enfants ou des parents vieillissants. Enfin, d’autres doivent avoir un deuxième emploi à la retraite, juste pour joindre les deux bouts.
Autre facteur : une économie en déclin et une population vieillissante se traduisent par un besoin amplifié d’aide à titre bénévole.
« Ces pressions accrues peuvent alors mener à l’épuisement au sein du petit nombre de bénévoles que les organisations ont encore », explique Mme Trauttmansdorff.
« Il y a tant de besoins et si peu de capacité », ajoute Mme Jurkovic.
Dave Clements a siégé à plusieurs conseils communautaires. À son avis, là aussi l’épuisement est une possibilité.
« Il peut être très lourd d’essayer de concilier les responsabilités professionnelles, personnelles, bénévoles et associées à un conseil d’administration », lance M. Clements, ajoutant que, dans un monde idéal, les gens donnent en fonction du temps et des capacités mentales dont ils disposent, et que cela devrait être adaptable. « Un conseil d’administration est un collectif, et parfois les membres s’enthousiasment, mais leurs idées ne les impliquent pas uniquement. Il revient aux présidents du conseil d’administration de s’assurer que l’organisation dispose de la capacité nécessaire pour prendre en charge quelque chose de nouveau. »
Gail Curran, qui est l’agente de l’engagement des bénévoles pour Retraités fédéraux, précise que l’Association compte 900 bénévoles au pays, mais qu’elle constate quand même de l’épuisement chez les bénévoles.
« Beaucoup de bénévoles sont fatigués, ils cumulent plusieurs rôles, leur santé et leur âge les rattrapent aussi », explique Mme Curran. « En 2023, notre taux d’attrition des bénévoles était de 23 %. »
Comment repérer l’épuisement
Ce qu’il faut surveiller si l’épuisement vous préoccupe :
- Si vous aviez l’habitude de parler de votre amour pour ce travail, mais que vous ne le faites plus.
- Si vous vivez des changements de personnalité au « travail ».
- Si vous admettez que vous êtes accablé, que vous vous sentez inefficace ou que votre impact importe peu, ce sont là des points qu’il faut également surveiller.
- Si vous étiez fiable et que vous cessez soudainement de vous présenter, de tenir des promesses ou de réaliser des tâches.
Il est important de repérer l’épuisement à un stade précoce, pour éviter que les bénévoles deviennent cyniques au point de ne plus voir l’organisation comme étant digne de leur aide.
Combattre l’épuisement
Selon Mme Jurkovic, les organisations ont besoin de plus de bénévoles pour répartir le fardeau émotionnel plus équitablement. Elles ont également besoin d’un financement soutenu, ce qui a été difficile à trouver.
« La réponse? Recruter plus de bénévoles », dit Mme Trauttmansdorff. « Et puis, lorsque vous en avez, montrez-vous vraiment bon avec eux. Il est important d’avoir un très bon gestionnaire des bénévoles. Ensuite, la formation est importante et il faut s’assurer qu’ils disposent de tous les outils dont ils ont besoin. Par exemple, s’ils livrent quelque chose, assurez-vous qu’ils ont les bonnes coordonnées et que tout ce dont ils ont besoin est bien organisé, afin qu’ils n’aient pas l’impression de perdre leur temps. »
La reconnaissance des bénévoles est également importante, indique Mme Trauttmansdorff. Les bénévoles ne sont pas là pour les récompenses, mais il est important de les remercier et de s’assurer que tout va bien pour eux. Elle suggère qu’un événement annuel leur rendant hommage lors de la Semaine de l’action bénévole en vaut la peine.
Un autre facteur consiste à s’assurer qu’ils ne doivent pas payer des choses de leur poche, à moins d’être prêts à le faire. Donc, si une tâche de livraison qui exige qu’ils paient pour le stationnement, assurez-vous que toutes les dépenses supplémentaires sont couvertes.
Façons de vous protéger contre l’épuisement du bénévolat :
- Maintenez une bonne communication avec votre organisation.
- Assurez-vous de comprendre ce que le travail implique.
- Faites l’essai du travail avant de prendre des engagements avec des échéances.
- Assurez-vous de bien comprendre les tâches à accomplir.
- Prenez des « vacances » de bénévolat, comme vous le feriez du travail.