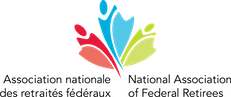Cheryl Young n’a pas grandi dans une communauté inuite. Toutefois, depuis l’âge adulte, elle embrasse sa culture et la transmet à ses enfants. Photo : Kyla Zanardi
Cheryl Young n’a pas grandi dans une communauté inuite, mais ses liens avec ses origines se sont renforcés lors de séjours estivaux au Nunatsiavut, où elle découvrait le mode de vie des Inuits.
Elle se souvient que la chasse se pratiquait collectivement. « On n’avait jamais à se soucier de la provenance de nos aliments », explique cette membre de Retraités fédéraux qui vit aujourd’hui à Valley, en Nouvelle-Écosse.
Ces étés étaient bien différents de sa jeunesse passée à Goose Bay, à Terre-Neuve, un endroit où on ne chassait pas et où elle aurait été gênée de porter des bottes en peau de phoque.
Aujourd’hui, cependant, ce n’est plus le cas. Elle assume pleinement ses origines inuites et en parle avec fierté. Maintenant à la retraite, elle est pleinement consciente des enseignements de sa culture sur le vieillissement et le respect des aînés. Les Inuits vouent un profond respect à leurs aînés.
L’approche algonquine
Peter Larivière, qui est aussi membre de Retraités fédéraux, a grandi selon les traditions algonquines de son père. « Dans la tradition algonquine, le vieillissement n’est pas perçu de la même manière que par les Canadiens qui viennent de l’Europe de l’Ouest », explique-t-il. « Chaque personne, quel que soit son genre, y compris les personnes bispirituelles, a un rôle à jouer. »
Vers la fin de sa carrière à Parcs Canada, M. Larivière, qui prenait soin de préciser qu’il ne parlait que des enseignements anichinabé et ojibwé qu’il a reçus, est devenu mentor. Les conseils qu’il donnait à ses collègues pourraient être utiles à ses camarades retraités.
« Soyez un peu égoïste », leur a-t-il dit. « Je ne veux pas dire au détriment des autres, mais prenez soin de vous. En prenant le temps de sortir, d’écouter les oiseaux et le vent dans les arbres, vous offrez à votre esprit un moment de tranquillité. Avec l’âge, je m’énerve plus facilement; il est donc important pour moi de pouvoir retrouver un sentiment d’appartenance à quelque chose de plus grand. C’est un des enseignements qui nous aide dans les moments difficiles de notre vie. »
M. Larivière dit qu’il a eu de la chance en ce qui concerne sa santé. Toutefois, en 2020, aux prises avec des problèmes de santé mentale, il a trouvé un thérapeute au Centre de santé autochtone Wabano, à Ottawa. « Certains des enseignements et des expériences de vie qu’il m’a transmis m’ont beaucoup aidé à me comprendre à l’approche de la retraite. »
M. Larivière évoque la roue médicinale algonquine qui accorde une place égale aux quatre phases de la vie : le jaune pour l’enfance, le rouge pour la jeunesse, le noir pour l’âge mûr et le blanc pour le troisième âge. D’après son expérience autochtone, le processus de vieillissement est circulaire, plutôt que linéaire, avec un début et une fin, comme on le décrit souvent. « On vous apprend très tôt qu’il n’y a pas de lutte de pouvoir entre les différentes générations. »
En vieillissant, M. Larivière se tourne souvent vers les enseignements de la roue médicinale.
« Je fais de la photographie animalière », confie-t-il. « Désormais, lorsque je prends des photos, je remercie ce qui m’entoure : un oiseau, un paysage, un arbre couvertde mousse. Je réfléchis davantage quand je suis à l’extérieur. Pour moi, cela fait partie du vieillissement : non pas penser à la vieillesse, mais à la vie, à ce qu’elle représente pour moi. Je deviens plus philosophe. C’est une façon de vivreplus en phase avec les traditions autochtones : réfléchir à sa place sur la Terre. »
Le rôle de la roue médicinale
Catherine Davis, professeure auxiliaire à l’Université Queen’s, titulaire d’un doctorat en études autochtones et membre de la Première nation d’Alderville, dans le sud de l’Ontario, a récemment exploré l’importance de la réflexion lors d’un webinaire. Elle a décrit sa présentation comme un survol de la vision anichinabé et ojibwé des différentes phases de la vie. La roue médicinale a servi de point de départ. Mme Davis a expliqué que, selon les enseignements, chaque passage d’une phase à l’autre revient à gravir une colline, où chaque étape apporte son lot d’expériences.
La roue médicinale donne un espace égal aux quatre phases de la vie : l’enfance, la jeunesse, le mitan de la vie et la vieillesse.
« Les collines symbolisent les obstacles et les épreuves que nous aurons à surmonter tout au long de notre vie », explique-t-elle. « Parfois, les défis peuvent se transformer en traumatismes. En observant les collines et en imaginant toutes les difficultés que l’on peut rencontrer pour gravir chacune d’entre personne plus compatissante. »
À la quatrième colline, précise Mme Davis, la vie ralentit et on se met à réfléchir. Le troisième âge est un cadeau, car il nous donne l’occasion de nous interroger : « A-t-on su honorer le don de la vie? » Un autre aspect de cette phase consiste à transmettre ses connaissances et à choisir ce qui mérite d’être transmis. « Grâce à ces connaissances, nous servons notre communauté », affirme-t-elle.
Depuis qu’il a fêté ses 60 ans l’année dernière, servir sa communauté est devenu une priorité pour Elroy White, un chef de la Première Nation Heiltsuk en Colombie-Britannique.
« Je me suis aperçu que je m’approchais un peu plus de la fin de ma vie; cette constatation ne m’a pas effrayé, mais m’a rendu plus productif. »
Fort de 19 ans d’expérience en archéologie à Bella Bella, en Colombie-Britannique, de son rôle dans les potlatchs cérémoniels et de trois ans comme chef héréditaire, M. White est depuis longtemps un pilier de sa communauté. Cependant, avec la ratification récente d’une constitution attendue depuis longtemps, il a saisi l’occasion de rendre son engagement officiel.
Selon lui, à cet âge, la plupart des gens veulent se poser confortablement et avoir moins de responsabilités.
« Pour l’instant, je ne ressens pas ce besoin. Je suis encore relativement en bonne santé, et mon esprit est toujours vif. C’est pour cette raison que je me suis présenté au conseil. Je ne veux pas quitter ce monde sans avoir redonné à ma communauté. »
Les potlatchs sont pour lui des symboles qui facilitent le processus de vieillissement. D’après les enseignements des Heiltsuk, l’identité et les connaissances culturelles sont représentées par certaines danses qui se transmettent de génération en génération. On a enseigné à M. White que, lorsqu’il aura du mal à exécuter les mouvements parce qu’il sera trop âgé, il sera temps de passer le flambeau à la génération suivante. Il transmet ainsi son respect pour la famille, la terre et la mer.
« Un jour, [mon petit-fils] va s’apercevoir que je fais moins de pas sur la piste, et il va vouloir s’occuper de moi et reprendre la danse. »
Avec ce processus générationnel traditionnel vient l’acceptation. M. White est serein d’avoir accompli son rôle et a foi en la continuité de la tradition, grâce à son petit-fils. Le mode de vie des Inuits
Pour Cheryl Young, servir sa communauté s’accompagne de souvenirs douloureux, mais est aussi porteur d’espoir pour l’avenir. Comme il a été mentionné, Mme Young a été exposée sporadiquement à ses traditions inuites à un jeune âge, mais elle avoue que son enfance a été marquée par les « mauvais choix » faits par sa mère. Elle est convaincue que, lorsque sa mère a quitté sa communauté et s’est détournée des siens, elle s’est engagée sur une voie qui l’a conduite à une dernière étape douloureuse de sa vie. Bien décidée à faire les choses différemment, Mme Young embrasse sa culture inuite et la transmet à ses enfants.
Toute sa vie, elle a été à cheval entre deux mondes, celui des Inuits et celui des non-Inuits. Lorsqu’elle s’est mariée avec un agent de la GRC, elle s’est de nouveau retrouvée dans le Nord, enchaînant les affectations tout en élevant sa famille. Elle raconte que ce mode de vie nomade était en harmonie avec ses racines, lui permettant de renouer avec les pratiques de ses ancêtres et d’inculquer la fierté culturelle à ses enfants.
Aujourd’hui à la retraite, Mme Young retourne à Goose Bay pour voir sa mère.
« J’ai été contrainte de prendre une décision très difficile : placer ma mère dans un foyer de soins », confie-t-elle.
« Quand elle était jeune, il n’était pas envisageable de placer un proche dans un foyer, car il n’y en avait pas », explique-t-elle, ajoutant qu’à l’époque, les aînés allaient vivre chez leurs enfants ou petits-enfants. Mais comme la démence avait commencé, les choix étaient limités. « J’en ai eu le cœur brisé. »
Mme Young fait tout ce qui est en son pouvoir pour rester en bonne santé et éviter de connaître le même sort.
Elle préfère la médecine naturelle aux médicaments sur ordonnance et fait régulièrement de l’exercice. Elle a aussi préparé ses plans de fin de vie et se sent rassurée de savoir qu’elle met en pratique toutes ses connaissances traditionnelles, tout en comprenant bien les lois canadiennes sur l’aide médicale à mourir.
Pour M. Larivière, la cérémonie demeure une bonne façon de préserver le lien avec les enseignements traditionnels. « La purification nous ramène à un endroit où nous sommes responsables de nous-mêmes », précise-t-il. « J’ai compris que ma plus grande force venait de ma proximité avec les enseignements qu’on m’a offerts, ainsi que ceux que je compte transmettre. »